Si la Corse est rapidement reliée au continent (Livourne - Macinaggio 1854),
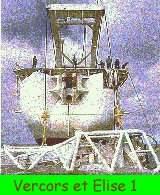 les grandes profondeurs de la Méditerranée s'opposent à la constitution rapide
d'un réseau souhaité par la France et les grands pays européens.
Il faudra attendre 1872 pour que le réseau mondial, centré sur Londres, desserve
le monde entier et ne cesse de s'étoffer pour atteindre une longueur de 650.000 Km en 1928.
Le réseau télégraphique restera en service jusqu'en 1962. Il est très rapidement abandonné
avec l'arrivée d'une nouvelle technologie : les câbles coaxiaux téléphoniques.
La longue histoire des câbles sous-marins à La Seyne sur Mer
les grandes profondeurs de la Méditerranée s'opposent à la constitution rapide
d'un réseau souhaité par la France et les grands pays européens.
Il faudra attendre 1872 pour que le réseau mondial, centré sur Londres, desserve
le monde entier et ne cesse de s'étoffer pour atteindre une longueur de 650.000 Km en 1928.
Le réseau télégraphique restera en service jusqu'en 1962. Il est très rapidement abandonné
avec l'arrivée d'une nouvelle technologie : les câbles coaxiaux téléphoniques.
La longue histoire des câbles sous-marins à La Seyne sur Mer
Aujourd'hui, le réseau de câbles sous-marins à fibres optiques construit depuis 1988 couvre le monde entier. D'une longueur équivalente à son ancêtre (650.000 à 700.000 km), il interconnecte les réseaux terrestres et permet de satisfaire plus de 90 % des échanges d'informations internationaux (téléphone et internet), alors que les satellites de télécommunications sont surtout utilisés pour la diffusion des programmes de télévision. La longue histoire des câbles sous-marins à La Seyne sur Mer
Depuis près de 150 ans, l'aire toulonnaise a toujours été associée à la grande aventure des câbles sous-marins et les navires câbliers s'y succèdent sans interruption depuis 1863.
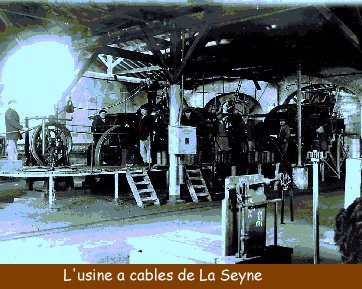
1 - Toulon et La Seyne sur Mer à l'ère du télégraphique.
Le premier service des câbles sous-marins est créé à Toulon, en 1863.
Il
est doté d'un atelier construit au Mourillon, aujourd'hui disparu, et
d'un navire acheté en Angleterre : le Dix décembre. Les premiers câbles
de desserte des îles côtières sont installés par ce navire en 1864 et 1865.
Par contre, les tentatives de pose de liaisons directes vers la Corse et l'Afrique du Nord
ne sont pas à la hauteur des espérances du pouvoir politique de l'Empire.
En 1878, le gouvernement décide de créer un secrétariat d'Etat aux Postes et Télégraphes,
rattaché au ministère des Finances. Celui-ci définit une politique de câbles sous-marins
pour la Méditerranée et sur l'Atlantique Nord. Au secteur public, le réseau des îles côtières,
les liaisons franco-anglaises et les câbles de la Méditerranée ; au secteur privé, dans le cadre
d'une convention avec l'Etat, les réseaux de l'océan Atlantique.
Un second navire, la Charente, est affecté au service des câbles sous-marins en 1874 et
basé à Toulon. L'Ampère (ex Dix décembre) rejoint la base du Havre.
En 1881, l'atelier du Mourillon, trop à l'étroit, est déménagé à Brégaillon sur un vaste
terrain bordant la mer. On construit une darse d'accueil de la Charente et une usine de
fabrication de câbles sous-marins.
Les premiers câbles directs Antibes - Saint Florent (1878) et Marseille - Alger (1879)
permettent de sécuriser les liaisons posées respectivement en 1866 et 1871.
Le débat du 1er juillet 1891 à la Chambre des députés est un dialogue courtois entre
le ministre Jules Ribot et le rapporteur du budget Alexandre Millerand.
Le ministre précise la politique du gouvernement Freyssinet à la lumière
des ambitions coloniales de la France et Millerand défend avec adresse le service public
et l'usine de La Seyne en souhaitant que les crédits pour la construction des deux câbles
Marseille-Oran et Marseille-Tunis soient affectés à l'usine de La Seyne.
Le rapporteur doit s'incliner devant la majorité républicaine et le " parti colonial ".
Deux usines privées sont construites à Calais par la société industrielle des Téléphones et
à Saint-Tropez par la société A. Grammont. Elles se partageront le marché.
La SIT achète un grand câblier de pose, le François Arago, qui installera les liaisons
construites par les deux industriels français entre 1892 et 1914.
Pendant 80 ans, l'usine de La Seyne fabrique ou rénove les câbles usagés relevés
au cours des réparations entreprises sur le réseau gouvernemental.
L'activité est discontinue ; l'allumage de la chaudière, avec la fumée qui
s'échappe de la cheminée qui domine la ville,signalent le début d'une production et
donc du recrutement de personnel temporaire. Usine et navires occupent 200 à 300 permanents.
En 1905, Marseille est reliée à l'Afrique du Nord par 5 câbles sur Alger,
Oran et Bizerte. Marseille est reliée à Dakar via Oran, Tanger, Cadix et les
Canaries. Les navires se succèdent : l'Ampère 2 remplace la Charente en 1930 puis
la darse accueille l'Emile Baudot, l'Arago, l'Alsace et le d'Arsonval.
L'Ampère 2,
construit à La Ciotat, est saisi par les Allemands et détruit en 1945 dans le port de
Marseille.
La conduite des navires est confiée à des états-majors et des équipages de la Marine
marchande et la conduite des réparations et des poses à des fonctionnaires de l'administration.
Après 1945, pendant que les navires Alsace, d'Arsonval et Emile Baudot remettent en état
le réseau télégraphique, le personnel de l'usine est très impliqué dans la définition
des premiers répéteurs téléphoniques et les expérimentations de l'administration et de
l'industriel français (CIT et Câbles de Lyon). Les deux premières liaisons téléphoniques
expérimentales sont réalisées entre Toulon et Ajaccio en 1946 et entre Cannes et Nice en 1950.
L'usine cesse la production de câbles télégraphiques dans les années 50 car la nouvelle
technologie des câbles téléphoniques assure la relève et conduit à l'abandon des réseaux
télégraphiques en 1962.
2 - La rénovation de l'usine et l'ère du téléphonique (1970 - 1988).
Les nouveaux câbles coaxiaux et les satellites se partagent le marché du téléphone à
grande distance.
Ils conduisent l'Administration à décider la rénovation du domaine en le
spécialisant dans l'entretien du réseau de Méditerranée. La reconversion permet de construire
successivement : le central téléphonique, la darse des navires câbliers avec deux quais
dans le cadre de la construction du port de Brégaillon, un grand entrepôt couvert de 18
cuves de stockage et un bâtiment pour les équipements de nouveaux câbles sous-marins
atterrissant aux Sablettes.
Nouvelle technologie, nouveaux métiers, nouveaux câbliers modernes.
L'industrie française se lance à la conquête du marché des câbles sous-marins.
La politique industrielle de l'Administration est claire : l'industriel construit des
liaisons téléphoniques clés en main qui sont posées par le navire de pose de l'administration,
d'abord le Marcel Bayard (1961-1981) puis le Vercors à partir de 1974.
L'administration définit les nouvelles technologies dans ses laboratoires de recherche
(CNET) et entreprend la promotion des nouveaux câbles. Le centre de La Seyne met au point les
techniques d'après-vente. Deux navires câbliers entretiennent les réseaux d'Atlantique et
de Méditerranée (Ampère 3) dans le cadre d'Accords de maintenance.
Le personnel de la base La Seyne est renouvelé. Les marins, souvent Pieds-Noirs et
africains (du fait de la suppression de la base de Dakar), ont remplacé les équipages corses
et marseillais de l'époque du télégraphique.
La mise en service du Vercors, en 1974, permet à l'idustrie française de conquérir
progressivement la Méditerranée autrefois acquise aux intérêts britanniques.
A la fin de l'ère du coaxial, le réseau a été construit à Calais à plus de 50 %.
Il est entretenu par les navires de La Seyne sur Mer. Le centre de Marseille est saturé par
7 câbles en service. Les dernières liaisons atterrissent à Martigues et à La Seyne à partir
de 1977. Ainsi, les câbles La Seyne-Bastia (1977), La Seyne-Tripoli (1979),
La Seyne-Grèce (1981) et La Seyne-Palerme- Alexandrie (1986) permettent à la base de La Seyne
de devenir un complexe unique au monde qui participe au rayonnement de la technologie française.
Des techniciens étrangers viennent se former aux techniques de jointage.
Des équipes
d'intervention sont envoyées pour remettre des câbles en service à Beyrouth et à Alexandrie
mais également à Colombo et à Singapour. D'autres équipes arment des navires de circonstance
en câbliers pour poser des câbles en Chine. D'autres enfin se succèdent à bord du navire
câblier Vercors qui assure un programme de pose soutenu.
En 2001, ce navire se place sur le podium des plus grands poseurs de tous
les temps avec plus de 110.000 km posés.
En 1983, deux nouveaux câbliers de réparation : le Raymond Croze à La
Seyne et le Léon Thévenin à Brest remplacent l'Ampère et le Marcel Bayard.
3 - L'intervention sous la mer et l'ère des fibres optiques (depuis 1980).
Les premiers câbles sous-marins à fibres optiques sont posés à partir de 1982.
Comme pour la génération précédente, l'administration des P & T et l'industriel
français installent leurs premières liaisons expérimentales en Méditerranée : A
ntibes - Nice (1982), Antibes - Port Grimaud (1984) et Marseille - Ajaccio (1987).
A partir de 1998, après la construction du transatlantique TAT 8, un troisième réseau se
met progressivement en place.
Du côté industriel, Alcatel signe avec Pirelli un accord de coopération dès 1987, ce qui
permet aux deux industriels d'éliminer le constructeur britannique de Méditerranée.
Pour Alcatel c'est un premier pas avant de s'implanter en Australie et aux Etats-Unis.
En 1984, après l'achat du constructeur britannique STC, Alcatel devient le premier
constructeur mondial.
En 2001, après une production de 70.000 Km dans ses trois usines de
Calais, Sydney et Portland, Alcatel doit faire face à la crise des télécommunications.
France Télécom connaît une évolution différente du fait de la dérégulation des télécommunications
dans la communauté européenne (1995). La direction de l'opérateur
s'impose de nouveaux objectifs : s'implanter dans le monde entier et construire deux
réseaux terrestres en Amérique du Nord et en Europe reliés par des câbles sous-marins.
Simultanément, des secteurs d'activité sont
abandonnés (Enseignement et Recherche), d'autres sont filialisés.
C'est ainsi que France Télécom Marine est créée le 1er janvier 2000 avec pour objectif
d'assurer la rentabilisation des quatre navires câbliers.
La base marine de La Seyne sur Mer perd sa fonction d'accueil des câbles sous-marins.
Ceux-ci quittent le littoral français puisque deux grandes liaisons à fibres optiques
ont été installées entre 1990 et 2003 : SEA-ME-WE 2 (1994) et France - Grèce (1996).
La Sicile est actuellement le centre du réseau méditerranéen.
Deux causes à cela : la nouvelle
réglementation française pour l'attribution des concessions d'atterrissement et le manque
d'investissement des opérateurs français dans le réseau. Le réseau italien stratégiquement
placé au centre du réseau méditerranéen possède également un réseau national de câbles
sous-marins longeant la côte occidentale.
Le réseau français est plus réduit :
outre les deux câbles internationaux, il ne comporte que la boucle
des îles d'Hyères, deux liaisons sur la Corse et deux câbles côtiers en Corse.
Le réseau mondial a atteint
650 000 à 700 000 Km en 2002, sensiblement plus qu'à l'époque du télégraphique.
 La période 1995 - 2000 a été faste pour les câbliers français.
La période 1995 - 2000 a été faste pour les câbliers français.
Deux navires de pose sont
en activité : le Vercors, qui sera remplacé en 2002 par le René Descartes, et le Fresnel,
nouveau navire construit en 1996.
Comme les câbles à fibres optiques sont systématiquement
ensouillés au fond de la mer au moment de leur pose, le développement des techniques
d'ensouillage avait été anticipé par les équipes de La Seyne sur Mer.
Déjà utilisé dans les zones à risque à partir de 1970, l'ensouillage a demandé un
effort de recherche pour maintenir l'outil à niveau.
Tout commença en 1974, à la mise
en service du Vercors. L'opérateur américain AT&T cherchait un navire de pose capable
de tirer la charrue et trouva un écho favorable auprès de son partenaire français.
L'administration accepta également de participer au programme de recherche du sous-marin
télécommandé SCARAB, lancé en 1975 et définitivement opérationnel en 1980.
En 1980, le Vercors, seul navire à exploiter la charrue américaine, est équipé d'une charrue
fabriquée par deux entreprises locales, SIMEC (Fuveau) et ECA (La Garde).
D'autres charrues suivront : Elise 2 et 3, les tracteurs autonomes CASTOR 1 et 2 et enfin
les sous-marins télécommandés (ROV) SCORPIO et HECTOR. France Télécom privilégie les engins
télécommandés de préférence aux engins habités et les rades des Sablettes, de La Ciotat ou du
Prado sont les lieux d'expérimentation des nouveaux outils.
Il y a une grande coopération entre tous les utilisateurs du milieu sous-marin situés
sur le littoral de la Méditerranée, entre les donneurs d'ordre, la Marine Nationale
(Certsm ou Gismer), Comex et l'industrie pétrolière, EDF, France Télécom.
Ils ont des objectifs différents et permettent aux nombreuses entreprises spécialisées
de participer à la conquête des abysses : Comex, Eca, Simec, Travocéan, Intersub, Cybernetic,
Sermar, Muller. Toutes ont apporté leur compétence, certaines sont toujours en activité.
Depuis 1990, les navires de pose Vercors et Fresnel mis en œuvre par les ingénieurs
et marins seynois posent les grands systèmes de câbles sous-marins dans tous les océans
du globe aussi bien pour Alcatel que pour les constructeurs américains ou japonais.
Entre 1997 et 2001, ils ont installé plus de 50% des 40.000 Km du SEA-ME-WE 3,
mais aussi des liaisons reliant le Japon aux Etats-Unis et l'Australie à Hawaï.
On reproche souvent à France Télécom de ne pas faire connaître localement
les réussites accumulées pendant cette décennie.
C'est sans doute exact mais les déplacements du personnel, les changements de programme
et les nombreux séjours à la mer des navires perturbent les opérations de relations publiques.
Gérard Fouchard
La longue histoire des câbles sous-marins à La Seyne sur Mer